« Trajectoires environnementales et sociales pour un futur souhaitable : un pas vers l’Anticipation » : Tremplin 2025 du R3 Futurs-ACT
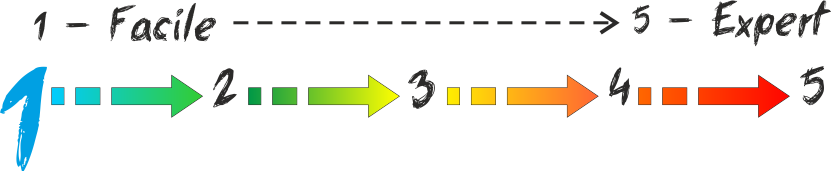
Bonjour à toutes et à tous et Bienvenue !
Cette année, les 12 & 13 juin 2025, le réseau régional de recherche (R3) Futurs-ACT a organisé deux demi-journées de son événement phare : le Tremplin, sur la thématique « Trajectoires environnementales et sociales pour un futur souhaitable : un pas vers l’Anticipation » (vous pouvez retrouver l'actualité correspondante en cliquant sur ce lien).
En parallèle de cet événement, deux side-events ont eu lieu :
- Un premier durant la matinée du 12 juin, la réunion du Groupe Action vulnérabilité du R3, où plusieurs intervenants ont pu discuter sur le thème « Les systèmes alimentaires face au changement climatique : quels défis et quelles perspectives pour la sécurité alimentaire à l’échelle des territoires de Nouvelle-Aquitaine ? » ;
- Un second au cours de la soirée du 12 juin, un ciné-débat sur le lien humain-nature, avec la projection du film « Le Lien » de Frédéric Plénard.
Comme durant le Tremplin 2023, Terres du Passé a participé à cet événement portant sur l'adaptation des territoires au changement climatique et se propose de vous en retracer ici les grandes lignes.
Si vous avez des questions, des demandes ou des sollicitations à formuler, n'hésitez pas à passer par le formulaire de contact.
L'ouverture de l'événement Tremplin 2025
Animé par la journaliste Pauline Boyer (co-créatrice et rédactrice de Soif, la revue de l'eau), l'événement a débuté par un mot de bienvenue de Benoit Sautour, coordonateur de Futurs-ACT, et Stéphanie Cardoso, membre du comité de direction du réseau.
Intervention de Benoit Sautour, coordonnateur du R3 Futurs-ACT, Professeur de l'Université de Bordeaux, membre d'AcclimaTerra et du conseil scientifique du PNR Périgord-Limousin
Au cours de son intervention, afin d'expliquer les origines du réseau régional de recherche Futurs-ACT, Benoit Sautour a mis en avant le constat de la « Grande Accélération », montrant ainsi qu'aussi bien les conditions environnementales que sociétales marquaient, depuis plusieurs décennies, voire plus d'un siècle, une brutale augmentation :
- Température de surface,
- Acidification de l'océan,
- Pêche marine,
- Aquaculture de crevettes...
Quelques éléments démontrant ici une tendance à la croissance, parfois exponentielle. Or nous vivons dans un monde fini où les ressources ne sont pas illimitées. En conséquences, les territoires sont impactés, parfois profondément, par cette évolution. La transition vers un nouvel équilibre est en cours et face à ce constat, il devient nécessaire de repenser le futur de nos territoires, notamment néo-aquitains. Pour cela, il faut créer une bascule dans notre rapport au monde et aux ressources et penser en termes d'adaptation et d'atténuation.
C'est sur la base de ce constat que Benoit Sautour et Denis Salles ont décidé de créer ensemble le R3 Futurs-ACT sur l'anticipation au changement climatique dans les territoires en transition de Nouvelle-Aquitaine. Deux notions clés pour ce réseau :
Adaptation
au changement en cours
&
Atténuation
réflexion sur les mesures à prendre pour atténuer notre impact sur les territoires.
Le travail du R3 Futurs-ACT se fait donc dans l'anticipation des changements, afin de réfléchir aux trajectoires à envisager. Cela se fait à l'échelle des territoires de Nouvelle-Aquitaine et dans un cadre mêlant Science et Société afin de co-construire des projets et des actions à mener. Une méthode employée est l'imaginaire : essayer d'imaginer les futurs possibles pour trouver des trajectoires efficaces et justes.
Dans ce contexte, l'événement Tremplin organisé par le R3 a pour objectif de mettre en avant les dynamiques locales et de permettre la mise en réseau des acteurs de la société civile avec les membres de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Intervention de Stéphanie Cardoso, membre du comité de Direction de Futurs-ACT, Maître de Conférence de l'Université Bordeaux-Montaigne, SHS Design fiction
À la suite de Benoit, Stéphanie Cardoso a présenté un autre aspect du R3 Futurs-ACT par l'importance de son interdisciplinarité et de son intersectorialité.
L'événement Tremplin 2025 nous pousse à réfléchir les actions à mener sous un angle différent, à se pencher sur les réalités du terrain afin d'éviter les écueils de la mal-adaptation. Stéphanie a ainsi accentué l'importance de la co-construction et de la réflexion collective pour arriver à des solutions.
Mais pour cela, il faut une culture partagée et les événements tels que le Tremplin ou les journées d'été d'AcclimaTerra sont précisément là pour nouer ces liens et partager cette culture, cette connaissance.
Par une approche prospectiviste, Stéphanie Cardoso a expliqué que co-construire l'anticipation au changement climatique revient à créer une dynamique prospective collective dans le but de saisir les opportunité des territoires et imaginer des modèles créant une rupture avec les dynamique actuelles qui ne peuvent perdurer, des scénarios, des défis innovants, des recherches et des outils à développer, et surtout, le maintien de la co-construction dans le passage à l'action.
L'aspect Science-Société est majeur et essentiel pour arriver à imaginer des scénarios. Il est nécessaire d'aller sur le terrain et de réfléchir avec la recherche pour poser les questions scientifiques qui sauront répondre aux besoins du terrain.
Intervention de Françoise Jeanson, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche
Françoise Jeanson, représentante de la région Nouvelle-Aquitaine, a ensuite mis en avant les point forts ayant motivé la création des réseaux régionaux de recherche, et notamment du R3 Futurs-ACT :
- Favoriser les relations de travail entre les établissements de recherche régionaux ;
- Augmenter la visibilité nationale et internationale des chercheurs néoaquitains ;
- Faire émerger des excellences régionales sur les questions de transition ;
- Communiquer sur les projets et les résultats des acteurs territoriaux, grâce notamment aux événements Tremplin.
Quatre points majeurs auxquels le R3 Futurs-ACT a su répondre au cours des cinq dernières années.
De plus, l'objectif au coeur de la création de ce réseau était, et est toujours, de promouvoir une science de l'anticipation au changement climatique.
Face à l'urgence de plus en plus prégnante du besoin d'action des politiques publics sur la thématique de la transition, et face au recul malheureux qui se produit dans les actions menées, Françoise Jeanson a exprimé la nécessité de s'arrêter pour regarder derrière soi et prendre du recul sur les besoins réels de chacun :
« [...] Ça pose aussi la question [...] de l'articulation des besoins du quotidien [...], des agriculteurs, [...] des urbanistes, [...] des entreprises... En regard avec la question de la survie de l'humanité, puisque c'est quand même le sujet de fond dont on parle aujourd'hui. »
Françoise Jeanson a également ajouté que dans le contexte régional de la Nouvelle-Aquitaine, la question de la transition climatique, aussi bien par la lutte ou l'adaptation, fait face à des difficultés de natures diverses :
- Économiques, avec le développement industriel, de la santé, de l'agriculture, etc. dans le but de recouvrer une souveraineté et une autonomie régionales.
- Militaires, dont les conditions instables nous amènent à parler pour la première fois de mener une « guerre écolo », ou en tous cas respectueuse de l'environnement.
- Démographiques, avec un vieillissement de la population régionale et donc une augmentation de la population fragile avec plus de 30% de « séniors ».
Enfin, la transmission des informations scientifiques réelles auprès des élus et des décideurs est essentielle pour éviter les écueils des rumeurs et des informations fausses ou biaisées qui pourraient leur parvenir et donc provoquer de la mal-adaptation. Il devient essentiel d'imaginer des solutions à la fois pour l'environnement et pour les sociétés.
Intervention de Philippe Moretto, vice-président en charge de la Transition et du Dialogue Science-Société à l'Université de Bordeaux
Philippe Moretto, représentant l'université de Bordeaux, a ensuite pris la parole. Il intervient pour la troisième fois au cours d'un événement Tremplin de Futurs-ACT.
M. Moretto a ainsi mis en avant le fait que les événements Tremplin étaient un lieu de rencontre entre la communauté académique, les étudiants et les parties prenantes de la société (politiques, socio-économiques, décideurs, associations, etc.). Cette rencontre permet d'engager une réflexion commune sur le monde de demain.
« [...] Il faut repenser notre avenir à l'aune des grands défis sociétaux, environnementaux, [...] et surtout faire appel à une intelligence collective. »
Il faut se projeter à 20-25 ans, et ce n'est pas facile, car les grandes questions auxquelles il est difficile de répondre sont : quelle société veut-on ? Quelle planète ? Quelle marche à franchir pour adopter ces transitions ?
Faire ce pas en avant ou ce pas de côté n'est pas évident, il est compliqué de se projeter.
Et c'est là qu'a été lancé la réflexion de l'établissement : quelle université à l'horizon 2050 ?
L'idée a été d'amener la gouvernance à se projetter à 25 ans par les scénarios de l'ADEME. C'est sur la base de ces scénarios qu'il va falloir avancer. L'université a lancé un programme du PIA qui s'appelle ACT : Le programme ACT, pour Augmented university for Campus and world Transition, vise à transformer les campus de l’université de Bordeaux en un laboratoire vivant et un incubateur de projets expérimentaux à l’échelle régionale au service des transitions sociales, sociétales et environnementales.
Ce programme permet de lancer des actions concrètes sur l'évolution de l'établissement et d'essayer de contribuer au débat et à des solutions concrètes. L'objectif étant de transférer les expérimentations menées sur le campus vers les territoires.
Un nouveau programme vient de débuter, une démarche participative : Grands défis en sciences de la durabilité. Devant se dérouler sur trois ans, les premières étapes de construction sont en cours. L'idée est d'aller des aspects scientifiques environnementaux vers les politiques publiques.
Intervention d'Elisabeth Worliczek, Grand Témoin, directrice de recherche, responsable de la plateforme internationale du Climate Change Centre Austria (CCCA), Université de BOKU, Vienne, membre de l'association autricienne du Pacifique Sud (OSPG)
À la suite des interventions de Futurs-ACT, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Université de Bordeaux, le Grand Témoin de l'événement, Elisabeth Worliczek, a pris la parole pour une conférence très inspirante sur les actions menées par la jeunesse de l'autre côté du monde : les Pacific Climate Warriors. Par cette conférence, Mme Worliczek nous montre l'implication de la jeunesse à travers la monde et les actions imaginées pour lutter contre le changement climatique.
Elisabeth met en avant une altération de l'attention des grands leaders mondiaux sur le changement climatique, notamment depuis la Covid dont l'impact et la période post-Covid ont entrainé un changement des priorités internationales : ils ont détourné leur attention des conséquences du changement climatique au profit de questions militaires et économiques.
Face à ce déficit d'intérêt, des jeunes se battent pour être entendus au niveau mondial. Les jeunes Pacific Climate Warriors ne veulent pas accepter que les îles du Pacifique se noient. Ils réfléchissent en termes d'anticipation.
« [...] la jeunesse veut influencer son propre avenir. »
Dans le Pacifique, il existe différents types d'îles :
- les îles hautes, volcaniques ;
- et les îles basses, de type atolls.
Si les îles hautes (s'élevant à plusieurs centaines, voire miliers de mètres au-dessus du niveau de la mer) ne vont pas se noyer au même titre que les atolls (ne dépassant quelques dizaines de centimètres à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer), les populations vivent sur la côte et vont se retrouver en difficulté avec la montée du niveau marin. Ce sont des terres qui vont être ennoyées dans un territoire où la terre elle-même est rare et précieuse, perdue au milieu d'une infinité d'océan.
Une montée des eaux implique un changement d'habitabilité des îles.
Histoire des Pacific Climate Warriors
Les Pacific Climate Warriors sont un réseau d'activistes non violents créé en 2011 qui se sont notamment faits remarquer en 2014 par le blocage du plus grand port de charbon du monde en Australie. Ils luttent essentiellement contre les combustibles fossiles et critiquent le mode de vie impérial.
Ils se battent contre le discours des îles qui coulent et des réfugiés climatiques.
Bien que l'océan Pacifique couvre presque la moitié de la planète, il est souvent négligé dans les réflexions sur le climat. Il représente de grandes ressources, est parsemé d'îles et ses habitants ont des cultures spécifiques, très caractéristiques.
Les warriors du Pacifique suscitent l'imaginaire des grands leaders mondiaux. Les guerriers du Pacifique sont passés d'une image coloniale, sauvage, à une image culturelle que l'on retrouve dans le sport (le rugby, etc.), le cinéma (Dwayne Johnson, etc.), les jeux vidéos, etc. Il y également les guerriers classiques, militaires, comme les casques bleus qui ont une grande importance aux Fidji par exemple.
Les Pacific Climate Warriors apportent une nouvelle interprétation du guerrier, refusant la figure patriarcale radicale : les warriors étaient autrefois des hommes et les Pacific Climate Warriors coupent avec cette tradition, les femmes sont également des warriors.
De plus, dans la culture des îles du Pacifique, ce sont les anciens qui agissent et qui prennent la parole. Les jeunes doivent rester silenceux, ne pas se faire remarquer. Les Pacific Climate Warriors dénotent avec cette tradition : ce sont les jeunes qui élèvent la voix et qui se font entendre à travers le monde.
Les armes des Pacific Climate Warriors sont les actions locales, les manifestations. Ils savent que les accessoires culturels attirent l'attention. Les orateurs sont également très doués, ils se font remarquer pendant les COP. Ils sont très présents sur les média sociaux. Ils essayent d'éduquer les populations et notamment les gens des îles du Pacifique. Cela les séparent de l'ancienne génération, qui n'était pas forcément éduquée.
La diaspora : il y a également une grande mobilité des idées et des personnes entre les îles du Pacifique et ailleurs. Il y a des liens privilégiés avec les anciens pouvoirs coloniaux. L'influence des idées est caractéristiques pour les Pacific Climate Warriors : ils sortent de leur propre contexte pour comprendre les différentes influences.
La motivation des jeunes est plus difficile à entretenir aujourd'hui : l'enracinement dans la terre est un rôle identitaire essentiel. La terre est une ressource limitée et précieuse. Il y a également une autre perception du temps par rapport à l'Europe : ceux qui étaient là avant et ceux qui seront là plus tard sont l'ensemble de ce qu'ils sont. Ils portent donc une responsabilité sur les générations à avenir. De plus, les ressources financières des îles sont limitées, ils doivent donc trouver comment sortir du rôle de victime passive.
Les politiques locales sont contentes que l'attention arrive sur le Pacifique grâce aux Pacific Climate Warriors . Dans les négociations globales, ce sont les îles du Pacifique qui veulent pousser la politique du climat. La politique des îles est favorable au développement durable, mais aussi à l'exploration des fonds marins pour l'exploitation des ressources, ce qui crée des tensions. Les Pacific Climate Warriors s'adressent surtout aux leaders mondiaux, aux pays industrialisés, car leurs propres gouvernements ne peuvent ou ne veulent pas aller assez loin.
Regards Croisés : « Imaginaires et pensée collective pour les mondes de demain »
Dans une intervention permettant de croiser les regards et les imaginaires de façon intergérationnelle,
- Julie Gabriel, étudiante en Master de la transition écologique à Science Po Bordeaux ;
- Sylvie Ferrari, professeure en économie écologique au laboratoire BSE de l'Université de Bordeaux ;
- et Guillaume Carbou, maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication au laboratoire Sciences, Philosophie, Humanités de Université de Bordeaux,
ont discuté de la pensée collective et de son importance pour mener à un monde de demain dans lequel l'humanité, en tant qu'espèce, peut trouver sa place entre les écosystèmes naturels et son fonctionnement en tant que société.
Intervention de Julie Gabriel, étudiante en Master de la transition écologique à Science Po Bordeaux
(Time code 01:21 - 04:25)
Pour Julie Gabriel, directement impliquée dans la transition écologique par la thématique de son Master, a l'habitude de se projeter et de penser à ce que sera demain, d'imaginer ce que pourrait être demain. Elle met en avant le fait qu'une pensée globale est implantée dans les esprits, par la société, par l'audiovisuel, par le monde qui nous entoure, et que s'extraire de cette pensée, notamment lorsqu'on est encore jeune, est une démarche volontaire et difficile.
Elle met en avant le dualisme Nature/Culture exprimé dans l'ouvrage de Descola (2022) et incite à recréer du lien entre les actions quotidiennes et la nature.
L'un des indicateurs nous poussant à regarder le monde d'une certaine manière est le PIB, par exemple, qui guide la plupart de nos politiques publiques, de nos gouvernances. Or le PIB est construit par l'humain et pour aller plus loin que ce que l'on nous donne à penser, il faut créer une rupture avec le fonctionnement de notre société tel qu'on le connait. On peut imaginer le monde suivant d'autres guides que ceux liés à l'économie.
Dans le monde d'aujourd'hui, il faut également toujours aller plus vite, plus loin, sans se demander réellement quel monde on souhaite pour demain.
« [...] en suivant cette dynamique, on va droit dans le mur, on y va très vite [...] et il faut repenser cet imaginaire-là pour essayer de l'éviter au maximum et de changer les trajectoires. »
Intervention de Sylvie Ferrari, professeure en économie écologique au laboratoire BSE de l'Université de Bordeaux (Time code : 04:25 - 10:40)
Comme Julie, Sylvie Ferrari nous explique que nous sommes actuellement dans la démesure, dans le « trop vite » et le « trop grand ». Sylvie nous explique que le modèle économique dans lequel s'inscrit la société actuel remonte à l'époque des 30 glorieuses, avec un imaginaire selon lequel avoir plus de choses, c'est encore mieux, être plus heureux, en meilleur santé, etc. Tout va mieux quan don a plus de tout, et c'est mieux encore lorsqu'on va vite.
C'était un monde, depuis les trente glorieuses, où l'imaginaire tournait autour d'un monde illimité. Malgré tout, un premier pas a été fait en 1972 avec la sortie du rapport Meadows, premier vrai cri d'alerte sur cet imaginaire et ses dangers (accumulation de biens de consommation, mais aussi de pollution).
C'est aussi un monde dans lequel se creusent les inégalités en plus d'une biodiversité de plus en plus malade. C'est le système capitaliste guidé par les créations de richesses.
« [...] Le PIB va également rentrer la restauration des milieux dégradés : on crée de la richesse quand on restaure, qu'on répare les milieux malades. »
Si on considère que le PIB n'est plus pertinent, quel indicateur proposer ? Le recul des inégalités ? Vivre plus longtemps et en meilleure santé ? La question du bonheur ?
Tout comme en environnement on dispose d'un état des lieux des écosystèmes terrestres et autres, en économie il existe également un état des lieux exhaustif de l'état de nombreux pays. Et sur ces bases, il est temps d'amorcer de nouveaux imaginaires et commencer à faire bouger les lignes, les frontières, à sortir des cases établies.
La difficulté est notamment lié à notre cerveau reptilien qui n'est pas préparé à des changements rapides.
La meilleure façon de parvenir à faire bouger les choses est donc de se tourner vers les jeunes, ceux qui sont l'avenir. Nous agissons aujourd'hui pour les générations futures, que nous ne connaitrons peut-être pas, mais nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux.
« Notre modèle économique est à bout de souffle et il faut envisager des transformations radicales. »
Intervention de Guillaume Carbou, maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication au laboratoire Sciences, Philosophie, Humanités de Université de Bordeaux (Time code : 10:40 - )
Pour Guillaume Carbou, s'il est important d'enjoindre la jeunesse à se mobiliser, il faut se rappeler que ce sont les "vieux" qui sont aux commandes aujourd'hui et que ce sont donc à ces titulaires, ces chef.fe.s etc. de prendre la responsabilité de l'action pour essayer d'apporter la rupture. Celles et ceux qui sont en poste dans les domaines politiques, économiques, etc., ont une responsabilité importante.
Pourquoi est-il important de modifier ces imaginaires ? Pourquoi les idées écologiques semblent toujours tourner court dans notre société ? C'est une réponse que Guillaume et d'autres collègues ont tenté d'éclairer dans l'ouvrage : "Green washing, manuel pour dépolluer le débat public" et dans lequel ils expliquent que :
« La plupart de nos façons de penser les transitions sont corsetées dans des imaginaires du "Business as usual", donc dans une dynamique capataliste dont on n'arrive pas à se sortir, [...] on n'arrive pas à penser à des modèles qui s'extrairaient du modèle marchand [...] pour aller vers des modèles publics, collectifs, sous le format du commun, etc. »
Un biais vient également de l'imaginaire technosolutionniste qui suppose que nos problèmes seront réglés par la technologie. Guillaume Carbou exprime également une opinion tranchée sur l'intelligence artificielle (IA), certifiant que quelle que soit la façon dont elle sera utilisée, son déploiement aura des conséquences néfastes.
Il ajoute enfin l'imaginaire sociétal actuel de la transition a une forme iréniste (idée d'une compréhension mutuelle entre toutes les parties, favorisant que ce qui rapproche les idées et minimisant ce qui les éloigne), c'est à dire que tous les acteurs de la transition peuvent agir ensemble main dans la main dans la même direction de façon fluide, linéaire. Or, pour permettre le changement, la transition, il faut des ruptures.
Table ronde 1/4 : Le monde rural de demain | Interventions d'Emilie Renaud (Créatrice de la marque "Les Toiles des Bergers") et Nicole Pignier (Professeure d’écosémiotique, Université de Limoges)
Table ronde 2/4 : Appropriation citoyenne pour une transition | Interventions de Manon Villalba (Chargée de mission Environnement et Développement durable, CPIE littoral basque) et David Glory (Docteur en Anthropologie sociale et en ethnologie au CeDS, Université de Bordeaux)
Table ronde 3/4 : Gestion des communs | Marc Pichaud (Chargé de mission Étangs et Qualité de l’eau – Parc Naturel Régional Périgord Limousin) et Camille Jonchères (Docteure en sociologie)
Table ronde 4/4 : Concertation citoyenne pour agir | Pierre Michel Etcheverry (Conseiller municipal de Menditte), Benjamin Tyl (Ingénieur de recherche à l’APESA) et Armelle Gomez (Docteure en sciences de gestion à Sciences Po Bordeaux)
Retours sur la session de l'après-midi : Pimnutcha Promduangsri (étudiante en Master 2, Université Côte d’Azur), Lara Frisch (étudiante en Master 1, Université de Bordeaux) et Elliott Lacour (étudiant en Licence 3, Université de Bordeaux)
Présentations flash des projets étudiants
 Terres Du Passé
L'histoire de notre Terre et de nos Océans
Terres Du Passé
L'histoire de notre Terre et de nos Océans
