 Une histoire archéologique riche
Une histoire archéologique riche
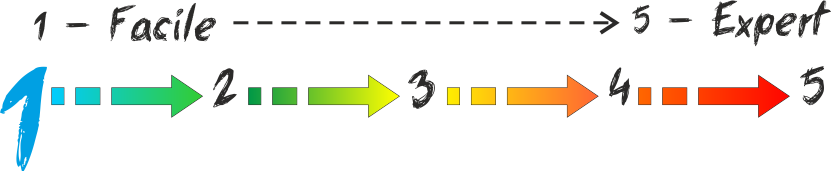
Le bas-Médoc à l'âge du Fer
L’âge du Fer correspond à la seconde partie de la Protohistoire et s’étend de 800 avant notre ère (soit environ 2 800 ans avant aujourd'hui) à la fin du premier siècle de notre ère (soit environ 1 900 ans avant aujourd'hui).
Durant l’âge du Fer, les groupes humains qui vivent dans les territoires correspondant à la France actuelle, donc les Celtes, les Gaulois, les Ligures, etc. n’utilisent pas ou n’ont pas développé l’écriture. Ce ne sont donc que les découvertes archéologiques et les récits des peuples grecs et romains ayant colonisé la Gaule qui ont permis de raconter l’histoire de ces sociétés humaines proto-historiques.
À cette époque, le Médoc était déjà une péninsule fermée au nord et à l’est par la Gironde et limitée à l’ouest par l’océan Atlantique. Cette disposition particulière et l’intense humidité de ce milieu rendent l’étude des populations qui ont vécu là à l’âge du Fer extrêmement intéressante. Voir de quelle façon les populations ont structuré leurs habitations et la répartition des villages est d’un grand intérêt pour comprendre leur fonctionnement et leurs méthodes d'adaptation à des conditions environnementales assez rudes. D’autant plus qu’à cette époque déjà, l’estuaire de la Gironde était une zone clé de commerce et d’échanges entre la Méditerranée et la façade Atlantique.
Le Médoc a la particularité de présenter deux visages très différents sur un territoire relativement restreint : d’un côté, à l’ouest, il y a la façade Atlantique, avec le cordon dunaire littoral et les grands lacs ancrés dans les formations sableuses des Landes. De l’autre, à l’est, il y a les terres fertiles et limoneuses de l’estuaire dans lesquelles poussent les vignes, entrecoupées de marais.
Sur la côte du bas-Médoc, entre Le Verdon et Montalivet, une grande quantité de vestiges archéologiques ont été mis en évidence, datant du Mésolithique à l’Antiquité. Les découvertes sont allées s’accélérant depuis les années 1960 au gré des marées et de l’érosion côtière mettant au jour des niveaux sédimentaires jusque-là enfouis. Les restes archéologiques sont régulièrement emportés par la mer, pour autant, les vestiges de l’âge du Fer révèlent une occupation dense de cette zone côtière, entre la dune littorale et les anciens marais.
Citation de Verdin et al., 2015 :
« Des portions entières de paysage se sont conservées dans les paléosols argileux et tourbeux qui apparaissent au gré du déplacement des bancs de sable. ».
Plage de La Glaneuse à Soulac-sur-Mer
Sur la plage de la Glaneuse, au nord de la plage de l’Amélie, des vestiges archéologiques sont visibles sur l’estran : trois alignements de trois rangées parallèles de poteaux orientés nord-est/sud-ouest. Ces alignements sont distants les uns des autres d’une centaine de mètres environ et sont implantés dans un banc d’argile grise à coquillages datés de l’âge du Bronze final (datation au carbone 14 de 1 430 à 1 150 ans avant Jésus-Christ, soit il y a environ 2 430 à 2 150 ans).
Ces alignements de poteaux ont été interprétés comme d’anciens pontons de pêche. Mais des difficultés demeurent dans leur positionnement et donc leur identification entre les différents auteurs, notamment ceux des années 1960 pour lesquels les données de positionnement GPS n’existaient pas.
 Terres Du Passé
L'histoire de notre Terre et de nos Océans
Terres Du Passé
L'histoire de notre Terre et de nos Océans
