 Histoire géologique du Bas-Médoc
Histoire géologique du Bas-Médoc
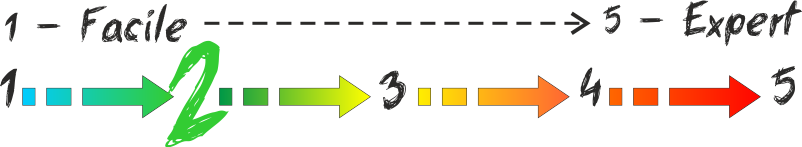
Bonjour à toutes et à tous et Bienvenue !
Aujourd’hui, Terres du Passé vous propose de continuer notre exploration du bas-Médoc en nous penchant sur la géologie de ce territoire particulier. Alors partons ensemble à la découverte du littoral nord-Médoc… et de son histoire !
I. De la géologie pour raconter une histoire
Le littoral atlantique du Nord-Médoc (ou Bas-Médoc) comprend de grandes falaises d'érosions argileuses : ce sont des affleurements pléistocènes désignés depuis le XIXe siècle sous le terme d'Argiles du Gurp.
Ces argiles ont particulièrement attiré l'attention des chercheurs après qu'une mâchoire fossile d’éléphant antique arborant encore plusieurs molaires y ait été trouvée en 1875.
La géologie permet de reconstruire l’histoire paléoenvironnementale et paléoclimatique d’un lieu. Pour lire cette histoire, il faut essayer de trouver les sédiments les plus anciens accessibles afin de regarder l’évolution des dépôts dans leur ordre chronologique.
Comme les sédiments les plus anciens se déposent en premier, puis sont recouverts petit à petit par les sédiments les plus récents, il faut partir des niveaux les plus bas accessibles sur la côte.
C’est ce qu’on appelle le principe de superposition.
Par exemple, sur ces images, ce sont les argiles noires, présentes au premier plan, qui sont les plus anciennes par rapport à toute la falaise que l’on voit en arrière plan. Les sables qui entourent les petites falaises d’argile noire sont remaniés par la mer et sont considérés comme des dépôts récents, car remis en mouvement et déposés sur l’estran en fonction des marées.
Vous avez un joli affleurement reprenant de façon continue cet enchaînement sédimentaire sur cette image :
Petite note en passant : un affleurement, comme son nom l’indique, est un élément qui affleure à la surface.
En l'occurrence, un affleurement en géosciences correspond à des niveaux géologiques qui apparaissent clairement, montrant des successions sédimentaires bien visibles, comme sur cette image.
II. De la base au sommet, le bas-Médoc des temps anciens
Afin de raconter l’histoire paléoenvironnementale et paléoclimatique du bas-Médoc, reprenons les travaux de Diot et Tastet des années 1990 ainsi que les travaux des équipes de Florence Verdin et Frédérique Eynaud de ces quinze dernières années (projets LITAQ, ESTRAN, Iconopastt, etc.).
Les Argiles du Gurp du littoral nord-médocain se composent en réalité de deux séquences sédimentaires :
- L'une margino-littorale, présente à la base et dont le sommet témoigne d'un niveau marin proche de celui de la période pré-industrielle, donc avant la remontée de niveau marin anthropique que nous connaissons aujourd’hui. Pour faire simple, un niveau marin proche de l’actuel. Cette séquence sédimentaire pourrait dater d'un interglaciaire précédent, peut-être l'Eémien, soit il y a la bagatelle de 120 000 ans environ.
- La seconde séquence, au-dessus de celle que nous venons de décrire, est continentale. Cette séquence, d'origine fluviatile, pourrait correspondre à un épisode glaciaire, avec un niveau marin bien inférieur à l'actuel.
Peut-être aurez-vous compris qu’une séquence sédimentaire est un ensemble qui représente des conditions particulières relativement communes. On a ici une séquence plutôt marine côtière suivie d’une séquence continentale : cela traduit un changement de niveau marin. Plus le niveau marin est élevé, proche de ce que nous avons aujourd’hui, plus il y a d’eau dans l’océan et donc moins les calottes continentales sont étendues.
Pour rappel, les calottes, ce sont les grandes accumulations de glace que l’on retrouve sur les pôles (actuellement au Groenland et en Antarctique).
À l’inverse, plus le niveau marin est bas, moins il y a d’eau dans l’océan et donc plus la quantité d’eau piégée sous forme de glace sur les continents est importante : les calottes polaires sont étendues et les glaciers de montagnes sont vastes.
Donc, plus le niveau marin est élevé, plus il fait chaud : c’est une période interglaciaire.
Plus le niveau marin est bas, plus il fait froid : c’est une période glaciaire.
C’est de la paléoclimatologie basée sur des interprétations paléoenvironnementales grâces aux sédiments !
Bien !
Les deux séquences sont séparées l'une de l'autre par un niveau de lignite d'un âge supérieur à 50 000 ans avant aujourd'hui. Le lignite, nous en avons entendu parler avec les grands incendies du sud-Gironde de l’été 2022 : les sols des forêts d’Hostens en sont remplis. C’est tout simplement une forme de charbon fossile avec une composition de seulement 55 à 75% de carbone.
L'ensemble des dépôts a été érodé et cryoturbé pendant le dernier maximum glaciaire, donc le Würm, avant d'être recouvert par les systèmes dunaires côtiers holocènes.
Les cryoturbations, du grec ancien cryo- qui veut dire froid/gel et doté du suffixe -turbation pour perturbation, ce sont des déformations du sédiments induites par le gel/dégel du sédiment.
La topographie de la surface pléistocène a été reconstituée par l'analyse de plusieurs centaines de forages et permet d'identifier une série de vallées convergeant vers l'estuaire de la Gironde. Ces vallées sont séparées par des zones hautes pouvant atteindre des altitudes de près de 10 m.
L'érosion côtière intense de ces dernières décennies favorise la mise au jour de ces paléovallées et formations pléistocènes.
Les affleurements pléistocènes se trouvent à la base des falaises d'érosion de la dune littorale qui les recouvre. Lors des marées basses de vives eaux et après des tempêtes hivernales, les affleurements apparaissent au niveau de basse mer. Malgré tout, le couvert sableux empêche d'observer en continue la totalité de la base de la coupe.
Sept formations ressortent de la base au sommet et permettent de reconstituer l’histoire de ce territoire.
III. Littoral/continental/littoral… l’alternance des périodes glaciaires et interglaciaires enregistrée dans les sédiments du bas-Médoc
1. La formation de la Négade
Il s’agit de la formation la plus basale, visible généralement durant les grandes marées basses. Elle se divise en trois niveaux qui suggèrent un dépôt pléistocène :
À la base, des argiles grises à lamines sablo-silteuses contenant des moules de lamellibranches (ancien nom des bivalves) (probable Scrobicularia), probablement de milieu estuarien.
Ensuite, des sables argilo-graveleux à stratifications obliques, dont un morceau de bois a permis de dater la base de ce niveau à environ 46-50 ka BP.
Au sommet, un poudingue de galets polygéniques d'environ 30 cm d'épaisseur ou moins, qui ne se retrouve pas partout latéralement mais seulement dans certaines zones.
Ce niveau s’est probablement mis en place durant un épisode unique et brutal de type crue exceptionnelle. Ce serait un témoin de la glaciation médullienne.
2. Argiles du Gurp s.s.
Ces argiles se composent également de trois niveaux superposés, essentiellement argileux. Elles reposent soit sur les galets de crue décrits ci-dessus, soit sur les sables argilo-graveleux. Elles sont vraisemblablement le témoin de dépôts marins très littoraux, lagunaires, d'une période de haut niveau marin interglaciaire (Éémien ou Holsteinien).
À la base, des argiles grises à laminées, présentant de très fines laminations silteuses.
Ensuite, des argiles vertes à laminées silto-sableuses pouvant faire entre 0,5 et 1 m d'épaisseur. Les lamines sont micacées et comprennent une microfaune littorale du type de celle qui se retrouve dans le bassin d'Arcachon. Les pollens confirment des conditions de dépôt saumâtres et un climat interglaciaire. Pour autant, d'importantes cryoturbations ont été identifiées dans certaines zones.
Au sommet, des argiles vertes à débit prismatique, plus homogènes. Des traces de déformation de compaction sont souvent présentes. Ces argiles peuvent faire 1 m d'épaisseur et comprennent un squelette d'éléphant antique dont de nombreux éléments ont été retrouvés, ce qui suggère un enfouissement naturel de l’animal dans des sédiments lagunaires. Cet éléphant serait un jeune Palaeloxodon antiquus, et le fait de retrouver des restes d'un animal de la même espèce dans la formation de la Négade est cohérent avec la répartition temporelle de cette espèce.
3. Lignite
Ce niveau de lignite noir peut atteindre 1 m d'épaisseur. Plus ou moins tourbeux, il recouvre les argiles du Gurp. Ce niveau est riche en bois flotté et débris de plantes aquatiques. Les données de datation carbone 14 ont données un âge d'environ 30 ka avant aujourd'hui, mais l'incertitude de mesure pousse à suggérer un âge autour de 50 ka BP ou plus.
4. Grès du Gurp
D'une épaisseur de 50 à 60 cm, ces grès sont présents sous la forme de plusieurs bancs à traces de courant. Ils ne sont pas présents partout latéralement et sont souvent assimilés aux sables fluviatiles du niveau supérieur.
5. Sables fluviatiles
Ce niveau se compose d'un complexe sablo-graveleux hétérogène, de couleur et structure variable, dont l'épaisseur varie de quelques décimètres à 5 m. Deux niveaux distincts composent ces sables fluviatiles :
À la base, des sables argileux grisâtres cryoturbés : dans les sables s'intercalent de fins lits d'argile grise ou bleutée ou de matière ferro-humique, ce qui témoigne de cryoturbations.
Au sommet, des sables et graviers argileux jaunâtres à coins de glace : ces niveaux sablo-graveleux à petits graviers finement stratifiés présentent une couleur ocre à jaunâtre avec quelques passes vert clair ou gris bleu dans des lamines argileuses. Des coins de glace sont clairement identifiés, structures ne se formant que dans des pergélisols dont la surface fond à la belle saison. En Aquitaine, les traces de tels sols se retrouvent entre 25 et 13 ka BP. Ces structures témoignent d'une température moyenne de l'air en-dessous de 0°C et inférieure de 13 à 19°C à l'actuelle.
6. Paléosol moyen
Il s'agit d'un paléosol tourbeux ou rubéfié dans lequel le sommet a révélé des restes archéologiques d'un atelier préhistorique (silex et débris de poterie), daté d'environ 11,5 ka BP.
7. Sables aliotisés
Ces sables marquent la limite entre Pléistocène et Holocène, ou la base de l'Holocène. C'est un sable jaunâtre à granule cimenté en alios humique noirâtre en surface. D'une épaisseur d'environ 1 m , sa base est légèrement plus grossière que son sommet. Ce pourrait être la partie supérieure du sable des Landes, recouvert par un horizon organique qui constitue la base des dunes.
 Terres Du Passé
L'histoire de notre Terre et de nos Océans
Terres Du Passé
L'histoire de notre Terre et de nos Océans
